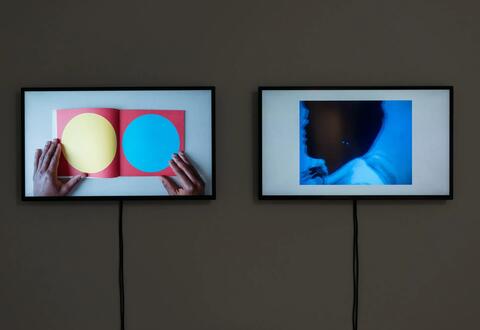![[Fig. 01] <i>Shimmer</i>, 1995.](/sites/default/files/styles/fixed_width_480/public/advancedpublications/text/13220/xshimmernelsonhenricksstill06min46s.png,qitok=tmsUsrB8.pagespeed.ic.mrkNGcrNTh.jpg)
La fin de la ligne(ée)
Nelson Henricks a quitté l'Alberta en 1991 pour s'installer à Montréal. Au début des années 1990, on assiste à l’émergence du mot «queer» dans le milieu universitaire, militant et culturel nord-américain anglophone1, bien que les gais, lesbiennes et transgenres de Montréal fréquentent depuis un certain temps le «Sodome-sur-le-St.-Laurent» (un bar montréalais considéré comme un refuge). À cette époque, contrairement à l'usage qu’on en fait aujourd'hui, le terme référait au refus d'une identité de genre ou d’orientation sexuelle unique et cherchait à nommer ce qui s’éloignait de la binarité.
![[Fig.02] <i>Conspiracy of Lies</i>, 1992.](/sites/default/files/styles/fixed_width_480/public/blocks/80033/xconspiracyofliesnelsonhenricksstill02min20s1.png,qitok=biOZgvmr.pagespeed.ic.PeFnIPRJS4.jpg)
Dans sa définition la plus large, le terme « queer » pouvait - et le peut toujours aujourd’hui - brouiller ce qui distingue les vivants des morts, la forme du contenu, l'artifice de l'authenticité, la rationalité de l’intuition, et bien d'autres choses encore. Cette émergence du terme queer est sans doute à l'origine de la création de deux œuvres vidéo exquises produites par Herricks dans les années 1990: Shimmer (1995) et Crush (1997). Dans ces oeuvres, le mot « queer » met en lumière l’imbrication des relations affectives entre le passé et le présent, entre le « soi » et l'« autre », ainsi qu’entre le corps et la voix.
Mais avant cela, Henricks a d’abord réalisé Conspiracy of Lies (1992). « En me rendant au travail aujourd'hui, raconte-t-il, j'ai trouvé des papiers dans une boîte à chaussures à côté d'une poubelle extérieure d'un immeuble d'habitation. En voici le contenu : quatre listes, trois pages et demie d'un journal intime, deux budgets, un numéro de téléphone au rabat d'un paquet de cigarettes et un fragment de photo qui a l’air de représenter deux personnes dans la cuisine d'un restaurant...» Dans le synopsis officiel, l'artiste déclare : « Quand j’ai trouvé ces pages de journal, j'ai supposé que l'auteur était un homme blanc et gay comme moi. J’ai alors fait appel à douze narrateur.trice.s de race, de sexe, de religion et d'orientation sexuelle différentes pour déstabiliser ma propre subjectivité et remettre en question ma conception de la différence. En fluidifiant davantage la frontière entre cet auteur anonyme et moi, je brouillais ainsi à qui revenait la paternité du texte ». Henricks confronte ici l'autre par le biais de détritus fragmentaires et éphémères, ce qui provoque une projection désirante qui a pour effet de rendre l’autre plus compréhensible et semblable à soi. Henricks a voulu se retrouver dans les traces de cet autre, et la vidéo représente ses efforts pour résister à cette impulsion. La vidéo devient le cadre conceptuel où la personne anonyme qui a laissé ces traces griffonnées derrière elle - ou lui, sans se douter qu'elles seraient analysées, peut expérimenter d'autres réalités (que la sienne). Pour cette vidéo, Hendricks a convié ses ami.e.s et collaborateur.trice.s Nik Forrest, Monique Moumblow, Steve Reinke et Yudi Sewraj à participer aux enregistrements des un.e.s et des autres.
Par ailleurs, la voix est devenue une préoccupation centrale dans l'œuvre de Henricks. Dans le discours contemporain, nous voulons que les gens se sentent « entendus », et qu'ils puissent entendre des voix « marginalisées » et demeurées longtemps inaudibles. Bien que la voix définisse fortement l'identité, elle est difficile à cerner. Celle de Henricks est une voix queer qui exprime tant l’artifice que l’authenticité. Le propre de l'ironie c’est de faire entendre le contraire de ce qu’on l’on dit, ce qui en fait une forme d'expression peut-être trop complexe pour notre époque où la façon de s'exprimer est plus littérale et didactique. La voix queer n'est pas apparue spontanément mais s'est construite à partir d’une histoire façonnée par la dissimulation, la transition, le subterfuge, la performance et la fragmentation des identités. La voix est puissante : dans une courte collaboration de Henricks et Forrest, My Heart the Devil (2002), la voix récite une incantation (Pretty Virgins Yes) qui libère des possibilités sataniques lorsqu’elle est jouée à l'envers, (Satan is Your Video). La voix a un pouvoir considérable.
![[Fig.03] <i>My heart the devil</i>, 2002.](/sites/default/files/styles/fixed_width_480/public/blocks/80035/xmyheartthedevilnikforreststill01min17s.png,qitok=MP_ZgFR6.pagespeed.ic.WTPTC4XA5a.jpg)
En 2010, Ingrid Schaffner a organisé l'exposition Queer Voice à l'Institute of Contemporary Art de Philadelphie. Pour contribuer au catalogue d’exposition, elle a invité un certain nombre de personnes à répondre à la question suivante : « Comment décririez-vous la voix queer? » Voici la réponse de l'historien de l'art Kenneth E. Silver :
« J'ai toujours été troublé par le fait que la voix dans ma tête - la voix agréable que je m'entends utiliser - n'a que peu de rapport avec la voix que j'entends quand j'écoute des enregistrements de ma propre voix, que je n'aime pas du tout. J'ai compris très tôt que c'était ma voix de queer que je n'aimais pas, et que je n’y pouvais pas grand-chose. J'étais coincé avec deux voix, l'une avec laquelle je vivais en harmonie, et l'autre que je projetais - et que je préférais ne pas entendre. Au bout d'un moment, le fait de pouvoir tolérer ce décalage entre la façon dont je m'imaginais et la façon dont ma voix sonnait ou dont je me «présentais » aux autres m’est apparue comme étant un certain talent, une forme de pouvoir et de connaissance de moi essentielle, de même qu’une clé pour trouver le bonheur. Ç’est également devenu drôle et rassurant : au lieu d'avoir juste un ennuyeux « moi », j’ai maintenant deux « moi », et nous sommes de grands amis ! »2
![[Fig. 04] <i>Shimmer</i>, 1995.](/sites/default/files/styles/fixed_width_480/public/blocks/80037/xshimmernelsonhenricksstill01min08s.png,qitok=ZqKTLTxk.pagespeed.ic.YayHu_DsoG.png)
Dans l'œuvre Shimmer (chatoiement) qu’il dédie « à maman et papa », Henricks regarde le passé pour mieux se projeter dans l'avenir, et s'interroge sur le sens qu’a le mot « maison » pour une personne homosexuelle ayant quitté son lieu d'origine. (Henricks se rappelle cette œuvre comme étant la première fois où il s'est senti « en contrôle» du médium). Le chatoiement (shimmering) est un effet de lumière qui s’observe en regardant quelque chose d'un point de vue spécifique; ce n'est pas un phénomène naturel mais l'effet d'une orientation particulière3. Les images de la vidéo, qui vont et viennent, sont éphémères; nous nous agrippons plutôt à la voix, qui perdure, en est le fil conducteur et le fondement. La voix provient du corps dont elle peut être séparée, décollée comme l’est une voix off. Henricks nous raconte une histoire tout en réfléchissant à la signification et au pouvoir de la voix parlée.
Il commence ainsi : « D'où viennent ces voix? Où vont-elles? Tout ce que je sais, c'est que j’ai quelque chose à vous dire et il faut que vous écoutiez. Vous écoutez et je ne sais pas pourquoi. Mais je veux vous le dire et vous voulez m'écouter ». Le narrateur - qui est à la fois « Henricks mais aussi pas Henricks » - nous met à l'épreuve en tant que spectateurs ou plutôt auditeurs. Il nous dit :« J’ai vu ça dans un rêve » et nous voulons le croire même si on ne peut s’assurer que c’est vrai. (L'artiste a-t-il le droit de parler d'une voix qui n'est pas la sienne?) Des images défilent : allumette allumée, cierge magique, pénombre, puis Henricks lui-même apparaît, spectral. On voit et entend des tentatives de communication : verre collé au mur pour écouter ce qui se dit de l’autre côté, signal vidéo distortionné. La voix est un fil chatoyant qui le relie à nous, de ses lèvres à nos oreilles. Des voix et visions se confondent :
« D'où ces visions viennent-elles? Où vont-elles? Des voix de derrière les murs. Des visions du fond de mes os. Et je ne sais pas pourquoi. »
![[Fig. 05] <i>Shimmer</i>, 1995.](/sites/default/files/styles/fixed_width_480/public/blocks/80039/xshimmernelsonhenricksstill05min14s.png,qitok=OY-C6P6G.pagespeed.ic.CQeyIJfV4M.jpg)
Le narrateur parle de sa famille, en particulier d'une grand-mère bien-aimée, dont l’édredon prend l'ampleur monumentale d'un paysage à travers l'objectif de la caméra. Il s’exprime en disant «vous » mais veut dire «je »: « Et vous vous sentez comme un hypocrite (parce que) vous vous ennuyez d’un endroit que vous savez détester. Vous le détestez plus que n'importe quel autre endroit au monde. Vous êtes juste en amour avec l'idée qu’il vous manque. Mais vous ne voulez surtout pas rentrer chez vous ». Les procédés qu’utilise Henricks permettent au « je » de devenir « vous ».
La voix commence à s'exprimer par « flashs » et fragments sur un rythme pulsé comme si elle cherchait à endiguer les morts : « Mille ans me traversent en un éclair. Je suis la fin de la lignée. Virus et bombes atomiques. Violence à un niveau moléculaire. Jeter les photos au feu. Le corps se retourne. » La fin de la ligne, c’est la fin de la lignée des Henricks - car cet artiste queer n'aura pas d'enfants et ne transmettra pas son nom à la prochaine génération - et c'est aussi la fin d'une ligne de son monologue : « il s’incarne dans sa voix, ses lignes (de texte) ». (He is his voice, his lines).
Henricks termine ainsi : « D'où viens-je? Où vais-je? M'écoutez-vous? Que peut-on ajouter sinon: Je serai bientôt à la maison? Je dois y aller. J'ai peur. Serre-moi. Ce qui me lie à toi est tangible. Presque réel. Ça va et vient, à la fois fort et fragile, voire frêle. Insupportable. J'essaie mais je ne peux pas. Je n'ai pas le droit. Ce qui me lie à toi s'estompe, glisse, disparaît et s'efface. C'est fini. » Où est la maison? Dans la vidéo, maintenant libérée de son rôle indiciel et qu'il aborde comme une voix, Henricks incorpore des séquences enregistrées et trouvées qu’il s’approprie, incarnant à la fois ce qui est extérieur et propre à lui-même. La vidéo, poreuse, est ouverte aux forces extérieures et nous relie fortement au monde. Le moi est ici un collage de ce que nous voyons et entendons.
![[Fig. 06] <i>The Hundred Videos</i>, 1989-96.](/sites/default/files/styles/fixed_width_480/public/blocks/80041/xthehundredvideovol4stevereinke35min49s.png,qitok=o8G0z2Gw.pagespeed.ic.N3q85FFeWg.jpg)
The Hundred Videos (1989-96), l'œuvre phare de Steve Reinke, maîtrise le rapport ironique entre mots et images en vidéo. Henricks a visionné attentivement ces bandes tout au long de la progression du projet et les a exposées à Montréal, poursuivant l’échange avec Reinke au fur et à mesure de leur production. Bien que Reinke assume la narration dans un grand nombre de ses œuvres - avec cette voix qui nous fait regarder autrement les images trouvées, il n'y a ni narration ni langage dans son unique collaboration avec Henricks, Harvey K, la 69e vidéo de la série (1995). Nous y voyons de brefs extraits de performances de l'acteur Harvey Keitel qui pousse des grognements, des gémissements, des cris, des souffles, des wacks - toutes sortes de bruits primitifs - mais sans prononcer un mot. Keitel y est incohérent et créatif tandis que des sons s’échappent de son corps et laissent dans leur sillage un magnétisme animal intense.
![[Fig. 07] <i>Static</i>, 1995.](/sites/default/files/styles/fixed_width_480/public/blocks/80043/xstaticnikforrest01min33s.png,qitok=ITatdFB6.pagespeed.ic.k4j8CW_fop.jpg)
Dans Static (1995), de Forrest, les voix sont celles d’hommes parlant à la radio ou à la télévision et qui montent en flèche les dangers que représentent les gays et lesbiennes en tant que « groupe marginal déviant » qui vit à l'écart de la société. Alors que le groupe est dépeint comme un objet de préoccupation, voire un problème social, nous voyons des corps au ralenti qui résistent ici à l'assaut des mots haineux. Ces mots, qui se superposent et s'accumulent en une cacophonie insensée, traversent les corps qui s'immobilisent pratiquement : l’un se déplace gracieusement dans l'eau, un autre boutonne sa chemise, deux personnes partagent un lit, une foule se déplace. Puis une autre voix s'élève calmement au-dessus du vacarme : « ... Vous faites ces gestes pour ne pas disparaître. Lors d’un processus de désintégration et de reconfiguration, les frontières (du corps) deviennent perméables... » Dans Static, (le son) de l'eau permet de brouiller le « bruit blanc » homophobe, de se réconforter et de faire confiance a ses désirs face à la diabolisation généralisée des minorités sexuelles.
![[Fig. 08] <i>Crush</i>, 1997.](/sites/default/files/styles/fixed_width_480/public/blocks/80045/xcrushnelsonhenricks03min05s.png,qitok=a3Eflie7.pagespeed.ic.o9-yzEMzM1.jpg)
L'éblouissant Crush, qu’a réalisé Henricks deux ans plus tard, présente la vision qu’a le narrateur d'un corps qui s'efforce de se transformer complètement, voire de s'effacer4. L'eau sert à nouveau de véhicule, mais pour souligner la mutation corporelle plutôt que la détermination5. Ce n'est pas une coïncidence si Crush fut réalisé peu après le pic de décès dus au sida au milieu des années 1990 et à peu près en même temps que des « cocktails » médicamenteux plus efficaces devenaient disponibles au Canada. Dans les années 1980 et 1990, la désintégration corporelle n'était pas une métaphore mais bien une réalité chez les amis et la communauté de Henricks. Devenir un animal6 est donc potentiellement salvateur. Ici, la voix s'étire et s'abrège, elle change de genre, ne vous laisse pas oublier qu'elle est aussi un corps; la voix est manipulée, poussée, tirée, musclée. L’intention du narrateur est de « devenir plus grand ou plus petit, de se tordre, de se plier, de s'étirer, se briser, changer de forme. Mais quelle est la meilleure façon d’y arriver? » La conscience qu’ont de leur corps les hommes homosexuels est démesurée : plutôt que de simplement perdre du poids, le narrateur imagine se couper les doigts : « Cette vision de la reconstruction ne s'intéresse pas à l'esthétique mais veut accélérer un peu l'évolution. Là où l'art et la psychanalyse peinent à créer une transformation réelle, la science fait des miracles ». Le fantasme d'une transformation radicale du corps n'est pas seulement ici décrit, mais aussi acté par le montage. On voit l’œil de Henricks entrecoupé par celui d'un cheval; des images de couteaux se faisant aiguiser et prêts à découper, entrecoupées par celles d’un instrument à cordes dont on entend les notes saisissantes. Ces mains qui blessent et construisent, guérissent et détruisent aussi. Le moi profond du narrateur est davantage incarné par la main que par la voix, mais ce moi est aussi éphémère qu'une poignée de sable :« Lorsque je serai devenu un animal, je me dissoudrai. Je deviendrai anonyme et interchangeable avec n'importe quel autre membre de mon espèce. Je veux moi-même disparaître, que le « je », que le « moi » disparaissent. Qu’il ne reste plus que l’enveloppe de mon corps abritant une identité vierge, libre. »
![[Fig. 09] <i>Rut</i>, 1998.](/sites/default/files/styles/fixed_width_480/public/blocks/80047/xrutyudisewrajstill01min52s.png,qitok=MZMPx0wS.pagespeed.ic.vAtnmJ0gMw.jpg)
Les œuvres de Moumblow et de Sewraj datant de la même période imaginent des transformations extrêmes et des fractures de l'identité similaires. Dans Rut (1998) de Sewraj, on voit un ours qui tente de se raser la fourrure du torse, dans le but peut-être de rejoindre l'humanité. La narration va comme suit : « Je me vois comme un ours », puis « Tous les autres me voient comme un homme dans un costume d'ours ». Dans une oeuvre précédente, Hybrid Creatures (1993), nous rencontrons une variété de sujets postmodernes, post-humains et postcoloniaux, dont « Jinhan le recycleur », qui imagine un « système complètement fermé » où « les organismes sont reliés entre leurs ouvertures fondamentales que sont la bouche et l'anus pour former un cercle complètement autosuffisant. La nourriture est ingérée à une extrémité, digérée, excrétée, puis entièrement recyclée et retournée avant de reprendre à nouveau le processus ». Dans le troublant Joan and Stephen (1996) de Moumblow, un gros plan de l'artiste s’adresse directement à l'objectif de la caméra : « Bonjour Stephen, c'est moi, Monique. Vous savez, si j'avais été un garçon, mes parents m'auraient appelé Stephen. Je n'arrive pas à m'imaginer en homme, alors j'ai décidé de t'inventer. En fait, je ne sais pas vraiment qui tu es. Au début, je t'appelais mon petit ami imaginaire, mais ça m'a paru un peu stupide, alors je pense que ce serait mieux de t'appeler mon amant... »
Si Shimmer traitait du passé, Crush se penche sur l'avenir. Les deux œuvres, cependant, se déroulent dans le contexte de disparition de la temporalité linéaire qu’a provoqué le sida. Une génération a été presque anéantie, des hommes jeunes et en bonne santé ont été rapidement débilités. Ceux qui ont disparu peuvent perdurer à travers leur art, mais aussi à travers les fantasmes que nous avons d'eux ou ce que nous voulons qu'ils aient été. En fin de compte, Crush se retire de l'avenir et revient au passé; alors que les transformations corporelles qu'elle imagine sont des miracles d'ingénierie, la vidéo propose de contrecarrer l’évolution et d'éviter le poids écrasant des problèmes propres aux humains. Il s'agit de déconstruire, de défaire, d’éliminer (to unalive) le moi (NDT: to unalive est un terme utilisé à la place de tuer, se suicider, etc., pour échapper à la censure des médias sociaux). Le corps passe sous le microscope et est jugé déficient; se transformer en animal est séduisant mais c’est un faux-espoir. Mieux vaut simplement beugler dans le vide comme Harvey K.
![[Fig. 12] <i>Crush</i>, 1997.](/sites/default/files/styles/fixed_width_480/public/blocks/80051/xcrushnelsonhenricks03min29s.png,qitok=GjZNAwHD.pagespeed.ic.V3UFb6a3Ld.jpg)
Je terminerai par la poésie qui clôt Crush, où le narrateur s'épuise à s'éteindre : « Non, je ne me souviens pas. J'oublie. Il n'y a plus de sens à trouver, plus d'espace dans ma tête, plus d'intérêt à apprendre ou à recommencer. Nulle part où construire une fois que je me suis démoli. Personne à qui parler une fois que je me suis reconstruit à partir de rien. J'oublie. J'efface tout ce qui me paralyse. Jour après jour, je me défais de l'histoire. Quand je serai libéré du passé, je serai libéré de mon devoir envers le futur. Il ne reste presque plus rien sauf une dernière chose : mes mots. Je m'en débarrasse comme d'une seconde peau. Je n'en veux plus. Le silence, enfin. (On entend une respiration) Les frontières du corps se dissolvent, deviennent perméables. Vous vous répandez, sortez à l'extérieur. Vous n’oublierez jamais cette sensation. Et si…quoi? »
- 1991 a également été une année charnière pour ce que le critique B. Ruby Rich a plus tard appelé le New Queer Cinema. Le film Poison, de Todd Haynes (l’entrelacement de trois histoires d'abjection et de transgression qui traversent le temps et les genres, avec Jean Genet comme figure de proue) et le film Edward II, de Derek Jarman (une romance historique postmoderne basée sur la pièce de théâtre de Marlowe écrite en 1592 - et où l’on voit dans une scène célebre une manifestation en faveur des droits des homosexuels dans un contexte contemporain) sont tous deux sortis cette année-là, et ont proposé avec éclat de nouvelles lectures pour penser les corps, la mémoire et la politique queer. Les films de Jarman, en particulier, ont été très formateurs pour Henricks alors qu'il était étudiant à l'Alberta College of Art.
- Queer Voice, éd.par Ingrid Schaffner (Philadelphie : Institute of Contemporary Art, University of Pennsylvania, 2009), 18.
- Henricks note que Shimmer fait également écho au mot français « chimère », créature monstrueuse et hybride de la mythologie grecque, mais aussi illusion ou fantasme réfuté par la réalité.
- Le livre Modern Primitives de V. Vale et Andrea Juno (San Francisco : Re/Search (#12), 1989), décrit en détail le tatouage, le piercing et les formes les plus extrêmes de modification corporelle.
- Il est assis dans une piscine et attend que son corps s'adapte : « Les nageoires, les branchies, les orteils palmés, le sonar - tout cela et bien d'autres choses encore viendront avec le temps. Mais après, l'objectif doit être de nager jusqu'à la mer. Immensément insatisfait d'être humain ».
- Voir Gilles Deleuze et Félix Guattari, Mille plateaux : Capitalisme et schizophrénie, trad. Brian Massumi (Minneapolis : University of Minnesota Press, 1987).




![[Fig. 10] <i>Joan and Stephen</i>, 1996.](/sites/default/files/styles/media_super_narrow/public/blocks/80049/xjoanandstephenmoniquemoumbloqstill03minn38s.png,qitok=vSaLFRqk.pagespeed.ic.wJG3OdQvZd.jpg)
![[Fig. 11] <i>Hybrid Creatures</i>, 1993.](/sites/default/files/styles/media_super_narrow/public/blocks/80049/xhybridcreaturesyudisewrajstill01min43s.png,qitok=rFBv7-g3.pagespeed.ic.IxIuadEaVu.jpg)
![[ Fig. 01 ] <i>Don't You Like the Green of A?</i>, 2022.](/sites/default/files/styles/publication_teaser/public/advancedpublications/text/13219/xdontyoulikethegreenofa06.jpg,qitok=_Rwq9IzO.pagespeed.ic.acokF5qyb7.jpg)